Texte & Publication
Une transgression impérative et pondérée - 2015
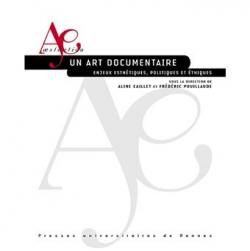
| Catégorie : | |
| Auteur : | Jacques Delcuvellerie |
| Tiré de : | Un art documentaire, Aline Caillet et Frédéric Pouillaude (dir.), 2017, Presses universitaires de Rennes |
| Date : | 2015 |
Le texte est paru dans Un art documentaire, Aline Caillet et Frédéric Puillaude 'dir), aux Presses universitaires de Rennes en 2017, actes du colloque international Un art documentaire, enjeux esthétiques, politiques et éthiques les 3,4 et 5 juin 2015 sous la direction d'Aline Caillet (Université Paris 1) et Frédéric Pouillaude (Université Paris Sorbonne)
Une transgression impérative et pondérée
Jacques Delcuvellerie
La connaissance acquise sans passer par les sens
ne peut donner naissance qu’à une vérité nuisible.
Léonard de Vinci
Cité par Christa Wolf dans Cassandre, Strock, 2003.
Il peut sembler a priori que les réquisitions spécifiques du théâtre et du documentaire s’avèrent inconciliables.
Du moins si l’on ne réduit pas le théâtre à une tribune, et qu’on l’envisage bien comme un art, c’est-à-dire une forme d’expression qui vise à produire une jouissance sensuelle. Chaque discipline artistique émeut un ou des sens de l’être humain selon des modes qui lui sont propres et entraine par là des effets complexes sur le cerveau, lesquels peuvent éveiller les fonctions cognitives, la spéculation, l’imaginaire, mais aussi des réactions « sensibles » : larmes, rires, euphorie, voire des états proches de l’extase ou de la catharsis.
Je rappelle ces évidences parce qu’il me parait nécessaire de les avoir bien présentes à l’esprit si nous examinons le caractère peut-être aporétique d’une relation du théâtre, comme art, au documentaire comme genre.
Quelle que soit la qualité d’élaboration artistique d’une œuvre documentaire, sa validation première – et sinon elle sort de ce champ – c’est l’authenticité des éléments de réel qu’elle expose. Imaginons qu’un film se présente comme un documentaire sur la Shoah et qu’il soit centré sur la personnalité d’un survivant du génocide. Ce film, très bien réalisé, pourrait obtenir un prix et connaitre une exploitation en salle, une édition DVD et, bien sûr, servir à animer des rencontres ou certains cours en milieu scolaire. Et puis, il se découvrirait d’un coup que le survivant est un imposteur dont la crédibilité tient au talent et non à l’authenticité de l’identité. Le scandale serait total. Le documentaire exige bien une validation d’origine contrôlée. Imaginons maintenant que le film ait avoué d’emblée le procédé et se soit présenté comme une œuvre de fiction, mais réalisé toujours sur le même mode, disons « à la Claude Lanzmann ». Le scandale serait peut-être moindre, le malaise resterait très profond. Et avec d’autres questions : comment peut-on oser pasticher un tel type de témoignage ? Comment un acteur peut-il avoir l’indécence de simuler une telle réalité ? Pourquoi ne pas avoir filmé un véritable rescapé ?
Ainsi, il y aurait – à juste titre – rejet scandalisé de l’œuvre présentée comme documentaire mais aussi rejet et opprobre si elle s’avouait fictionnelle. Dans un cas parce qu’on ment : ce n’est pas un rescapé, et dans l’autre… parce qu’il le joue trop bien ? Dans tous les cas, ne s’énonce-t-il pas, implicitement, une prescription impérative : « ça », on ne le « joue » pas ? Or, une telle prescription serait mortelle pour le théâtre, l’art par excellence de la simulation.
De ce point de vue, le théâtre se verrait donc interdire (ou devrait se refuser à) la mise en scène de certaines réalités humaines. Ce qui pour le théâtre comme pour tous les autres arts, semble absolument inadmissible. « Que rien en ce monde ne me soit étranger » pourrait être la devise même de l’exploration artistique. Devrait-il alors se résoudre à ne l’aborder que de manière réservée, se tenant dans une zone « de bon goût » et de non-dérangement ? A ce compte, quantités d’œuvres d’art n’auraient jamais été entreprises. Ce devrait être, au contraire, une des motivations à se risquer au genre documentaire, en tant qu’artiste, que de produire un objet capable de toucher et d’éclairer le spectateur de telle sorte que sa vision du monde en soit dé-rangée – au moins en partie.
Le théâtre peut-il à la fois procurer intensivement la jouissance spécifique dont il est porteur, répondre pleinement aux exigences de validation du genre documentaire, et – de surcroît – dé-ranger notre regard sur le monde au point d’y susciter, jusqu’à un certain point, une nouvelle co-naissance à celui-ci ?
Tenter de répondre à cette question nous ramène d’abord aux spécificités essentielles de l’art dramatique. Le théâtre, à la différence des autres arts, tire sa force singulière de produire de la réalité vivante sur scène, physiquement, dans un espace/temps partagé, ici/maintenant avec le spectateur. Mais cette réalité se présente ouvertement comme une simulation du réel (on le « joue »).
Cette description/définition relève trois éléments fondamentaux, constitutifs de l’identité de l’art théâtral, et donc de la jouissance particulière qu’on peut y éprouver :
§ - Il produit de la réalité vivante
§ - Cette réalité se donne pour un simulacre du réel
§ - Le phénomène est vécu dans un espace/temps commun, partagé ici/maintenant.
Je me répète dans un effort de clarté parce que, précisément, chacun de ces trois éléments s’avère composite et l’ensemble du phénomène de la représentation constitue en lui-même un événement complexe, impur, trouble, ambigu.
1/ La représentation produit effectivement de la réalité vivante. Les acteurs y sont en chair et en os. L’écran qui brûle ne détruit pas le film et si la pellicule brûlait le film existerait toujours ailleurs. Un incendie sur scène anéantit la représentation, seule réalité théâtrale concrète[1]. Si l’acteur meurt en scène à l’acte 2, il n’y aura pas d’actes 3 et 4. Cependant, la concrétude vivante de la représentation se produit au croisement indécis de deux réalités hétérogènes. Celle, disons, du réel-réel et celle du simulacre. Définir ou situer le niveau ou la nature du réel-en-scène peut-être extrêmement délicat.
Un acteur, au détour d’une réplique ou d’un geste de son partenaire, est suffoqué par l’émotion et se met à pleurer – c’est dans les larmes, pour un certain temps, qu’il continue cependant à jouer… Qui pleure ? Bien sûr, dans ce contexte scénique, c’est le personnage. Mais ce sont néanmoins les glandes lacrymales de l’acteur qui les produisent, une réalité du réel-réel. Et pour qu’elles adviennent, l’acteur a dû accepter de laisser toucher en lui à des zones secrètes, intimes, qui lui appartiennent en propre, en tant que personne réelle. Et la réalité (réel-réel) de l’émotion qui en résulte chez le spectateur – il pleure également ou, au contraire se referme – n’advient elle-même que par l’ambiguïté du statut de réalité de ce moment. Les larmes de l’acteur ne suffisent pas à provoquer cette émotion. Si celui-ci perdait complètement le contrôle de lui-même, le spectateur serait certes très perturbé. Il quitterait lui aussi, comme l’acteur, l’ordre de la représentation : ses émotions ne se rapporteraient plus au contexte de la pièce mais au réel-réel de l’acteur en crise. Mais, généralement, non : l’acteur bouleversé dit ses répliques avec exactitude et, dans ses larmes, se tient avec précision à sa partition : la gestuelle, les déplacements, etc. Autrement dit, le spectateur est d’autant plus touché qu’il ressent l’acteur à la fois comme « hors-de-lui-même » et en pleine maîtrise. Moment exceptionnel inscrit dans un ensemble où cela fait sens. Par l’art de l’acteur, cette transgression pondérée manifeste brièvement à un haut degré deux aptitudes propres à notre espèce mais rarement conjuguées : suivre fidèlement un processus conscient (le travail élaboré qui a permis à cet instant de se produire) et, en même temps, se laisser emporter comme dépassé par ses propres émotions.
La transgression pondérée s’apparente à un phénomène transcontextuel. Les larmes du personnage appartiennent au contexte fictif de la fable : elles peuvent même faire partie des didascalies. Les larmes réelles de l’acteur en personnage et en situation frôlent la limite du contexte-des-contextes : l’ordre de la représentation. Celui dont le réel-réel est exclu, celui où l’on ne tue pas vraiment, on ne viole pas vraiment, etc., mais où on peut pleurer vraiment ? Caresser vraiment ? Où se situe la limite ?
À peu près tout ce que la représentation met « en jeu » de véritablement puissant présente ce caractère trouble. Roméo et Juliette s’embrassent passionnément, deux êtres de fiction, mais dans cette action « fictive » les acteurs mêlent réellement leurs lèvres, leurs langues, leurs salives… Avec tous les signes de la passion … mais sans s’aimer réellement … afin de produire du plaisir à un voyeur … et tout cela pour de l’argent !… Quel métier est-ce donc là ? Et vous prétendriez de plus, n’en être pas affectés une fois quittée la scène ? Mais quelle espèce de monstre êtes-vous ? Et vous appelez cela « de l’art » ? Comme du Bach ou du Picasso ?
De longue date, la pratique du comédien et celle de la prostitution voisinent. On comprend l’interdiction du théâtre dans plusieurs sociétés, sa condamnation pendant des siècles par l’Eglise, et l’élaboration de formes de représentations tentant de restreindre voire d’éliminer tout ce qui tient à cette interférence de deux ordres de réalité. C’est pourtant là un constituant majeur de la jouissance spécifique à l’art théâtral. Les représentations dont ce trouble est absent s’oublient facilement. La vie scénique dépend fortement de la capacité à faire vivre de manière sensible la perturbation de cette limite entre deux réalités hétérogènes.
Tout ceci module déjà fortement notre assertion : la représentation théâtrale produit de la réalité vivante mais celle-ci se donne ouvertement pour un simulacre du réel. En effet, si la représentation scénique n’existe qu’à se séparer de l’ordre du réel-réel, elle en admet néanmoins des interventions aux fins mêmes de la production vivante de simulacre... Cependant il serait tout à fait erroné d’en tirer la conclusion que cette limite inquiétée n’existe pas, qu’elle ne serait qu’un tabou de convenance à ignorer. Cette limite est fondatrice du théâtre. Sans elle, nous sommes à la messe ou à la corrida.
Le religieux, le sacré, c’est l’ordre du réel-réel. Pour le croyant, le Christ s’incarne vraiment dans l’hostie par le mystère de la transsubstantiation, il ne s’agit pas d’un spectacle symbolique.
Le théâtre se distingue aussi radicalement des spectacles dont la forte charge symbolique est portée par des événements réels-réels : les compétions sportives, les jeux du cirque antique, les exécutions publiques, etc.
On ne peut donc se prévaloir d’une certaine indécision de cette limite pour la rejeter purement et simplement. Qu’elle soit perturbée peut, à certaines conditions, offrir une jouissance singulière au spectateur, précisément parce que dans sa transgression cette limite est encore perceptible. J’ai dit en d’autres lieux :
« Il paraît évident qu’aujourd’hui on use et abuse sur scène de « réalités » : animaux, fluides corporels, nudités incessantes, corps handicapés ou malades, enfants, documents audiovisuels choquants de toutes sortes, écriture-collage de citations, spectateurs participants ou traités en cobayes, actes violents ou sexuels réels, actes religieux d’autres cultures décontextualisés, etc. Bien sûr, tous et chacun de ces signes, comme tels, peuvent créer leur légitimité. Certes. Mais ni greffes monstrueuses ni escalade d’électrochocs ne rendent par eux-mêmes vie à la représentation scénique momifiée. Seulement : ce qui naît ou s’éteint à la limite fragile que la représentation scénique produit elle-même et, jusqu’à un certain point : contre elle-même. [2] »
Ainsi, dans la société du spectacle, la tentation d’abuser de la monstration de réel-réel est permanente, mais on ne saurait non plus s’en prémunir en se tenant au dogme : au théâtre rien n’arrive « pour du vrai ». L’actrice qui dira : « Mais je ne suis pas toute nue, c’est Lulu » n’empêche personne de connaitre désormais sa « vraie » paire de seins. Peut-on oser exposer de la réalité documentaire au moyen d’une forme dont l’indécision de statut du réel qu’elle manipule lui confère un caractère presqu’obscène ?
2/ Cette difficulté se redouble du fait que la représentation scénique, à l’exact inverse de ce que nous avons tenté de décrire jusqu’ici, tend à déréaliser ce qu’elle expose et à tout incorporer à l’ordre de la fiction.
Ce phénomène s’illustre bien dans l’historiette célèbre : un soir, dans un théâtre, un incendie se déclare, hors de la salle, et progresse rapidement. Le bouffon de la pièce entre en courant sur la scène et supplie le public d’évacuer au plus vite… Un immense éclat de rire lui répond, plus il insiste, plus il en fait, plus on rit… Si vous vous risquez au théâtre à caractère documentaire, comment procéder pour faire vraiment toucher au spectateur la réalité qu’on évoque, quand c’est au moyen d’une forme qui tend à fictionnaliser tout ce qu’elle produit ?
3/ Dernière caractéristique fondamentale de la jouissance particulière à la représentation vivante : le phénomène vécu dans un espace/temps commun, partagé, ici/maintenant. À dire le vrai, c’est bien par-là, et seulement par-là, que ce phénomène appartient au réel-réel. Tout ce qui advient sur le plateau relève de la réalité scénique et celle-ci, nous l’avons vu, est d’une complexe ambiguïté. Mais que de vrais acteurs et de vrais spectateurs vivent vraiment ensemble un événement qui se produit dans une structure spatiale et une durée communes, cela appartient indéniablement au réel-réel. C’est, à nouveau, une tendance lourde du théâtre actuel de convoquer cette réalité dans la représentation. On ne compte plus les spectacles joués face public (même si l’on joue une scène entre personnages), les adresses directes au spectateur, les entrées par la salle, les remarques « improvisées » sur ce qui est en cours sur scène ou dans le public, etc.
Fiction ou documentaire, un usage sensible et raisonné de ces « transgressions », devenues à leur tour des clichés, dépend de la qualité des réponses apportées à ces deux questions de base : que veut-on au spectateur et dans quel but ? C’est de là que tout peut se déduire et s’évaluer.
Sur le caractère peut-être inconciliable des réquisitions spécifiques du théâtre comme art et du genre documentaire, il se dégage, à ce stade, une forte présomption. Si le théâtre, comme art, s’engage dans la voie documentaire, il ne saurait y jouer un rôle « productif » (ce qui nous semble une des réquisitions minimales du genre) qu’en appliquant la bonne vieille règle du « non-pas-mais ». Devant ce double bind de devoir traiter d’un événement réel, de le rendre dans sa concrétude effective, dans une forme dont la nature est de produire du simulacre, et de le rendre également intelligible et interpellant, par ce même moyen d’expression bien plus apte à produire de l’émotion vivante et partagée entre scène et salle qu’à développer de l’analyse et du raisonnement, devant cette double contrainte, le « non-pas-mais » pourrait s’exercer ainsi.
Non pas réduire ou simplifier le phénomène complexe de la représentation vivante à la fin supposée que cela permette de restituer et de dire plus clairement l’événement réel, mais, en fonction de ce que l’on veut au spectateur, laisser l’événement réel déranger les réquisitions spécifiques de l’art théâtral sans pourtant cesser de vouloir les rencontrer.
Autrement dit : expérimenter, et tester les tentatives de l’expérience. Au sens fort : les mettre à l’épreuve. Vérifier, avec des spectateurs, si le théâtre y perd sa force singulière, si l’événement s’y obscurcit, si les effets de nos essais sont producteurs de sens ou non.
Nous ne nous essayerons pas à décrire les réquisitions propres au documentaire avec autant de précision que celles posées par l’art théâtral, mais il est au moins une exigence à rappeler. Qui s’aventure dans le champ documentaire prend une grave responsabilité, très différente de celle ordinairement portée par l’artiste.
Que celui-ci accepte ou non les appréciations ou les critiques suscitées par son œuvre, il se pose bien comme « responsable » de sa qualité et, en principe, défend le point de vue qu’elle exprime. S’il s’estime, c’est parfois le cas, comme le seul autorisé à juger de sa production, il s’en trouve toujours – et là, d’autant plus : responsable. Dans le genre du documentaire cette attitude nous paraît bien légère, et même : inadmissible. L’auteur porte ici une responsabilité aussi envers d’autres : ceux qu’il évoque, dépeint, interroge, dans la situation donnée qu’il explore. Créer du documentaire sur le génocide des Tziganes, c’est prendre une responsabilité dont l’auteur se trouve comptable non plus seulement envers lui-même, mais aussi envers tous ceux qu’il « met en scène », au 1er rang desquels les victimes.
C’est une situation très particulière dans le champ artistique et que le Groupov a vécue avec une grande intensité lors des représentations de notre spectacle Rwanda 94, une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants, en particulier au Rwanda même. Les spectateurs dans la salle y étant les protagonistes réels de tout ce que la scène faisait revivre et interrogeait. Parfois des parents proches d’une victime évoquée nommément. Une telle responsabilité impose aux auteurs des devoirs particuliers. Et pas seulement quant à la véracité des informations ou la justesse des points de vue, mais aussi sur le plan artistique. Toute médiocrité devient une forme d’insulte. Les morts et ceux-qui-auraient-dû-mourir, les rescapés, nous imposent en quelque sorte de ne rien entreprendre dont la seule mesure serait l’autosatisfaction. Il faut entendre ces voix muettes. Elles vous contraignent à dépasser les peurs, l’orgueil ou les réelles insuffisances, pour qu’advienne quelque chose qui dépasse vos capacités initiales.
Et ceci nous amène à deux autres questions. Si, en dépit de ce qui semble a priori contradictoire, le théâtre s’engage dans le champ documentaire, quelles conditions devrait-il s’imposer à cet effet ? Et quels moyens doit-il se donner ?
Sur les conditions, peut-être devrions-nous procéder par la voie négative, c’est-à-dire en éliminant de ses ambitions ce à quoi d’autres formes d’expressions atteignent beaucoup plus naturellement, plus complétement, plus justement que lui.
* Le théâtre ne transmettra jamais de l’information documentaire avec la même richesse et la même précision qu’un livre, une thèse, une enquête approfondie. Cinq cents pages d’étude minutieuse et référencée sur un phénomène précis offrent infiniment plus de matériaux factuels et de mises en perspectives structurantes que ne le peut une œuvre dramatique. Celle-ci, sur ce plan, ne pourra même pas – et de loin – égaler une solide conférence sur le même sujet.
Mais il n’est pas si simple pour le théâtre se risquant dans le champ documentaire de renoncer à cette dimension informative. Que faire quand l’événement auquel on s’affronte est très mal connu du public, et son contexte encore moins ? Une œuvre se situant dans le cadre du génocide des Juifs peut compter sur une relative connaissance des faits par le spectateur, mais dans le cas des Arméniens ? Ou celui des Tasmaniens ? On frôle le néant. Ce qui entraîne un dilemme très concret. Ou bien le théâtre entreprend néanmoins de combler comme il peut ce vide et se heurte au fait d’être à la fois bien mal outillé à cette fin et d’y altérer, voire d’y compromettre complètement la nature « artistique » de son travail. Ou bien il y renonce et se concentre sur des réalités beaucoup plus restreintes. S’il s’agit de la guerre en Tchétchénie dont le public ignore à peu près tout, il ne tenterait pas d’évoquer la spécificité du conflit (origines, belligérants, enjeux politiques et économiques nationaux et internationaux, oppositions idéologiques, culturelles, etc.), et pourrait, par exemple, donner simplement à entendre la correspondance de soldats avec leurs mères. Cela, tout le monde peut le recevoir sans contextualiser. Mais, de fait, la dimension documentaire s’y réduirait à cette seule part : ces lettres. On pourrait dire que le spectateur sortirait de ce théâtre sans doute très touché et, en même temps, très peu informé, très peu « documenté », sur cette guerre. L’empathie et l’émotion suscitées, réveillant seulement cette évidence : la guerre est un phénomène cruel…
* Le théâtre ne peut prétendre non plus à rivaliser avec le film documentaire – ni même la photo – pour présenter au spectateur des traces « réelles » du phénomène à évoquer. S’il s’y essaye, son travail de monstration (un cadavre, le sang qui coule, les ruines d’une ville, une bombe au napalm…) avoue d’emblée son caractère factice. De cette stylisation ou cette facticité il peut tirer sa force propre, mais dans le domaine de la prise de contact sensible avec l’événement réel les images ont un pouvoir sans comparaison[3]. De fait, selon moi, le théâtre ne devrait même pas songer à entreprendre de remplir la même fonction. Vouloir figurer de manière « réaliste » des exécutions massives, des tortures, des affamés agonisants, tout cela s’avère le plus souvent impossible et obscène. Cette obscénité ne tient pas à la violence des situations qu’on tente de représenter (de ce point de vue, les viols et les meurtres de la tragédie élisabéthaine ne sont pas obscènes). Et l’obscénité objective d’une réalité ne suffit certainement pas à la proscrire de représentation. Non, ce qui rend révoltant cette option « réaliste » dans le théâtre à caractère documentaire c’est la vanité aberrante de l’entreprise. Quel objectif poursuit-on, consciemment ou non, quand on croit avoir besoin de « jouer la comédie » pour figurer, dans le cadre du réalisme documentaire et non d’une fable imaginaire (la tragédie), l’agonie dans les chambres à gaz ou les égorgements dans les rues de Kigali ? Quel point de vue cela révèle-t-il sur les êtres représentés ? Sur le phénomène de la représentation ? Sur ce qu’on veut au spectateur ?
Voilà donc un peu plus balisée, par la voie négative, une possible incursion du théâtre dans le champ du documentaire. Elle ne devrait tenter de se substituer ni au livre, ni à l’image, ni vouloir représenter l’irreprésentable.
On pourrait se dire qu’à ce compte, il ne lui reste plus à emprunter que sa vieille route ordinaire : la mise en scène d’une histoire avec personnages (fussent-ils « historiques »), soit, comme on aime le dire au cinéma : une fiction basée sur des faits réels.
Il y faut généralement un auteur et une pièce, au sens traditionnel, ou encore l’adaptation d’un roman où tout le travail de mise en jeu des événements réels a déjà été accompli. Cette perspective n’a rien de spécialement exaltant en ce qu’elle n’offre rien de nouveau à affronter dans l’expérience artistique de la scène. De nombreuses pièces du théâtre dit « documentaire » se révèlent plutôt pauvres sur le plan créatif. Au mieux, cela donne « Le Vicaire » de Rolf Hochhuth, critiquant l’action du Pape Pie XII pendant la 2ème Guerre Mondiale, en particulier à l’égard des Juifs. Pièce ensuite portée au cinéma par Costa Gavras, et – de fait – on pourrait dire de ces pièces qu’elles ne semblent attendre que cela : devenir des films. À un niveau théâtralement et politiquement beaucoup plus élevé, on trouve des réalisations telles que « L’histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge » d’Hélène Cixous, créée par Ariane Mnouchkine avec le Théâtre du Soleil, ou le « Discours sur le Vietnam » de Peter Weiss. Vous aurez relevé le long titre de la pièce d’Hélène Cixous, voici le titre complet de celle de Peter Weiss : « Discours sur la genèse et le déroulement de la très longue guerre de libération du Vietnam illustrant la nécessité de la lutte armée des opprimés contre leurs oppresseurs ainsi que la volonté des Etats-Unis d’Amérique d’anéantir les fondements de la Révolution. » S’il entre dans un tel titre un brin de coquetterie d’écrivain, s’y exprime aussi une intention de démarcation radicale d’avec le théâtre ordinaire, y compris « documentaire ». Nous sommes là très loin du « Vicaire » mais tout autant des lettres de soldats tués en Tchétchénie. Le documentaire est ici envisagé à partir d’une tranche d’histoire comme une lecture du monde dont la mise en forme est dictée par la nature spécifique de son sujet.
On se trouve avec Cixous et Weiss devant deux œuvres qui ne s’en tiennent pas au descriptif et qui, du même coup (comme c’est étrange…), s’inventent une écriture scénique originale. Cixous –dans son lien étroit avec une compagnie telle que le Théâtre du Soleil cela se réalise encore plus naturellement – et Weiss, produisent de la représentation potentielle. L’écriture ne se réduit pas à des dialogues, des situations « reconstituées », elle inclut dans son projet la théâtralité même. Elle invite à différents styles de jeu, modulations spatiales et temporelles, expressions musicales, chorales, voire « chorégraphiques », etc. Ce qui ne trahit aucun formalisme, mais se trouve requis parce que la complexité du sujet traité amène aussi à l’envisager sous différents angles et à le traiter sur divers modes.
Peut-être plus aboutie encore que ces deux œuvres magistrales : « L’Instruction », du même Peter Weiss. De ce procès réel à Francfort fait en 1964 à des criminels nazis, Weiss tire une œuvre (un oratorio) en onze chants. Tout le texte de la pièce est tiré des minutes de ce procès, paroles des juges, des avocats, des témoins, devenus des vers sous sa plume. Ces onze chants forment une structure qui décalque l’œuvre de Dante – et non pas l’Enfer comme on pourrait le croire, mais le Paradis… Sans détailler davantage, la mise en forme de ce procès réussit cette prouesse de n’oser (à juste titre) aucune fiction, respectant totalement l’événement, et en même temps de le transmuter en une œuvre épique de la plus haute exigence. Aussi, fait non négligeable, dans une telle structure les acteurs peuvent « jouer », au plein sens du terme, c’est-à-dire : libres dans le code d’une convention acceptée.
Ces quelques exemples, mais il faut le dire : d’exception, montrent que le théâtre peut rencontrer la « vocation » documentaire aux conditions :
1/ de ne pas prétendre à figurer ce qu’il ne pourrait que trahir et banaliser
2/ de s’inventer une dramaturgie originale parce que déduite des spécificités de l’événement lui-même et de l’interpellation dont elles sont porteuses
3/ d’oser expérimenter hardiment – mais de négocier avec suspicion – l’élaboration des matériaux du spectacle. Toute dramaturgie trahit une conception du monde. La représentation en gestation gagne en force d’être consciente des surdéterminations idéologiques qui se disputent son projet
4/ de placer le spectateur au centre des préoccupations, créant les signes de la représentation de manière à toucher vivement sa sensibilité en même temps que d’éveiller à une intelligence des faits
5/ de comprendre la nécessité et se donner les moyens d’initier et gérer la dynamique collective qu’implique toute œuvre documentaire à la fois « authentique » et créative. Fut-elle écrite par un seul, l’œuvre dramatique documentaire implique une intense confrontation aux autres. Enquêtes, rencontres, écoute attentive, immersion, en ce qui concerne l’événement (même s’il appartient à un passé révolu), et une intelligence de la dialectique individu / collectivité dans la mise au travail et l’accouchement de la représentation
Tout ceci m’amène à évoquer l’expérience personnelle et collective vécue au Groupov pendant la décennie où il s’est affronté à la réalité du génocide de 1994 au Rwanda. D’abord pendant les quatre années d’élaboration de l’œuvre, ensuite par sa diffusion, les films réalisés, les rencontres qu’ils suscitent. À vrai dire ce travail se poursuit encore.
Je ne saurais évidemment exposer ici tous les problèmes rencontrés par une telle entreprise. Je m’en tiendrai seulement à ce qui se rapporte au titre de cette communication : Une transgression impérative et pondérée. En effet, la gestation de Rwanda 94 s’est trouvée en quelque sorte contrainte à opérer certains dérangements transgressifs dans l’ordre de la représentation scénique. Dérangements que nous n’avions nullement anticipés.
En rappelant brièvement la nature de l’événement à l’origine du projet et la perception que nous en avons eue à l’époque, on saisit sans doute mieux pourquoi ces « transgressions pondérées » se sont imposées.
1/ L’événement auquel Rwanda 94 s’est confronté est :
* Un génocide. L’extermination en trois mois de 800.000 à un million de victimes. Donc un phénomène énorme, monstrueux, de ceux qu’on dit souvent « indicibles »
* Un génocide très mal connu de l’écrasante majorité des citoyens du monde, sur tous les continents, y compris l’Afrique. Et, de surcroît, quasi invisible. Le « Monde Diplomatique » avait un jour titré : « Un génocide sans images »
* Un génocide récent. Rescapés, témoins, bourreaux, sont encore vivants. Les forces génératrices ou complices du crime existent toujours, au Rwanda comme à l’étranger. D’où, aussi, différentes formes actives de négationnisme : virulent et militant, ou embarrassé mais toujours vivace – comme en France – et, dans tous les cas, dans le déni de toute responsabilité
* Enfin, un génocide accompli et subi par des êtres humains d’une culture singulière, très différente, par exemple, des cultures congolaises ou de l’Afrique de l’Ouest. Une culture étrangère aux occidentaux actuels et exprimée, notamment, dans une langue pour nous difficile.
De l’autre côté, au point de départ de ce travail, la perception que nous avions de l’événement, la réaction qu’elle provoquait, on pourrait dire : le soulèvement originel. Cette impulsion initiale a la forme d’une double révolte, extrêmement violente :
* Devant les événements eux-mêmes. Cette extermination perpétrée dans l’indifférence et la passivité générales. Les morts n’avaient pas de nom, pas de visage, pas d’importance
* Devant le discours qui constituait ces événements en informations, à la télévision, la radio et dans la presse. À de rares et belles exceptions près, la « tragédie rwandaise » s’y présentait comme une « guerre tribale », un « massacre inter-ethnique », problème « typiquement africain ». La responsabilité de l’ONU et des occidentaux ne semblait en rien engagée dans ce qui apparaissait implicitement comme une résurgence de la barbarie nègre dès que les Européens ont tourné le dos.
Cette double révolte se retrouve au travail dans l’ensemble du projet. Il tente de rendre aux victimes une voix, une individualité, une dignité, que bourreaux et communicateurs leur ont déniées, avant, pendant et après leur mort. Il interroge, par ailleurs, les origines et les formes de cette dramaturgie de l’information par laquelle l’événement devient opaque, falsifié, utilisé à des fins partisanes.
Après un an de lectures studieuses et de rencontres (experts, témoins, rescapés), après un premier voyage, après que, déjà, aient surgi certaines écritures[4], nous fûmes en mesure d’énoncer la ligne structurante d’élaboration du projet : « une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l’usage des vivants ». Elle a fini par devenir le sous-titre de cette création, chacun des termes de cette « définition » a joué un rôle concret, celui d’inspirer des pistes mais aussi de rejeter certaines tentatives ou d’abandonner certains essais[5].
Tout ceci postulait clairement une œuvre qui ne serait ni de déploration, ni même de deuil ou de mémoire seulement, mais où les causes, les processus, les responsabilités seraient aussi explorées. C’est ainsi que nous entendions : « à l’usage des vivants », pour que cette « tentative de réparation », on puisse, idéalement : s’en servir. Qu’elle s’efforce de contribuer à rendre « résistible » les abominations en gestation dans le monde présent.
Il découlait de cette orientation toute une série d’obligations pratiques dont nous n’avions aucunement les moyens à l’époque.
* De prévoir un temps d’élaboration beaucoup plus long qu’ordinairement au théâtre, et de plus sans pouvoir lui fixer une échéance précise. (recherches, essais, erreurs, débats, ré-écritures, etc.)
* De « marcher sur deux jambes », c’est-à-dire de ne pas entièrement distinguer une phase d’étude et d’enquête d’une phase de création de formes. Oser écrire ou composer ou filmer et continuer à tenter de « savoir », en même temps. Laisser cette dialectique modifier réciproquement les chantiers artistiques et le programme d’apprentissage
* L’ensemble du projet conduisait manifestement à une œuvre protéiforme, de vastes dimensions, notamment dans sa durée
* Tenter de « réparer symboliquement » envers des morts que nous ne connaissions pas et dont nous ignorions la culture, exigeait que des « anges gardiens » rwandais soient consultés et/ou associés pendant l’élaboration des propositions pour la scène. Une part de ces anges vigilants serait membres du collectif de création et d’autres des extérieurs de confiance
* Tentant cette réparation « à l’usage des vivants », il fallait absolument nous assurer que ceux-ci soient en situation de nous entendre. Davantage, il fallait créer un chemin qu’ils désirent suivre avec nous jusqu’au bout. Ce qui impliquait de savoir si ce qui s’expose parvient clairement ou non. Est-ce que tel moment ou suite de moments repousse, choque inutilement, lasse, distrait, frustre, épuise, sème la confusion ou, au contraire… etc. Il nous fallait donc ménager à ce work in progress des rencontres publiques ponctuelles, d’abord confidentielles, puis de plus en plus larges (spectateurs par centaines). Observer les réactions, écouter les remarques, les questions, les critiques, les suggestions, décanter, faire des choix, retravailler. Ces rencontres eurent bien lieu. Dernière étape avant la création « définitive » : les représentations au Festival d’Avignon 1999, avec cinq heures de matériaux texte-image-musique-jeu qui allaient encore être profondément modifiés jusqu’en mars/avril 2000.
Ainsi, la méthodologie d’accouchement de Rwanda 94 s’écarte très fortement du processus dominant dans la production théâtrale, il a demandé à celle-ci de sortir des limites ordinairement imparties à une mise en scène (quelques semaines de répétitions) et a dû accepter l’incertitude de sa finalisation[6].
Pour ce qui est de certaines transgressions pondérées dans l’ordre de la représentation scénique, elles se rapportent avant tout aux trois moments-clés du spectacle :
* Le témoignage de la rescapée, Itsembabwoko
* La conférence sur les catégories identitaires Hutu/Tutsi et l’histoire du Rwanda, Ubwoko
* La Cantate de Bisesero, bâtie sur les témoignages de la résistance armée sur ces collines et le massacre de 50.000 personnes.
Il est significatif que ces moments essentiels, situés au début, au milieu et à la fin du spectacle, soient précisément ceux qui décalent quelque peu les limites convenues de la pièce de théâtre.
* Le témoignage initial opère la rupture la plus évidente avec le « simulacre » du théâtre. Histoire vraie racontée par celle qui l’a vécue[7]. Devant des spectateurs qui en ignorent à peu près tout, la « réparation symbolique » ne pouvait avoir lieu sans qu’ils soient d’abord mis en présence du génocide. Son réel-réel. Le Groupov choisit ici de renoncer à l’évoquer comme phénomène de masse et ne propose non plus aucune image de l’événement. Avant tout, nous rencontrons une personne. Et nous (re)vivons l’Itsembabwoko de l’intérieur, avec Yolande Mukagasana, celle-qui-aurait-dû-mourir, au moyen d’un récit.
À l’exception des premières lignes (des vers) il n’est pas écrit, et donc susceptible de variations. Par exemple, un souvenir d’enfance brusquement resurgi. Ou bien, présentant ses enfants, il lui est arrivé de dire : « Nadine, 13 ans. C’est aujourd’hui son anniversaire, elle aurait 19 ans ». Cette pure oralité donne à toute sa narration une qualité d’ici/maintenant très vive.
* La conférence centrale « Ubwoko » dure environ une heure, exactement comme le témoignage. Elle tente d’éclaircir la problématique soulevée par le récit de la rescapée (« Je veux savoir pourquoi mes enfants sont morts. »). De même, les spectateurs quelque peu submergés de questions après 2h30 de représentation, ressentent aussi fortement la nécessité d’en savoir davantage. Par exemple : Hutu/Tutsi, qu’est-ce que cela veut dire ? La conférence est donnée comme le témoignage : sans texte strictement écrit et sans images. Elle peut varier en fonction du public et des circonstances. Puisque le théâtre est assurément très mal adapté à la communication d’informations complexes, Groupov fait le choix de ne plus se soucier de savoir si c’est encore du théâtre ou du thaètre[8], et opte pour une véritable conférence[9].
* « La Cantate de Bisesero » correspond exactement à son titre, elle ne relève donc pas du théâtre en tant que tel. Sa part de drama (action) est inexistante et ses exécutants : musiciens, choristes, récitants, ne jouent aucun autre personnage qu’eux-mêmes. Cette forme conclusive du spectacle s’inscrit pour nous en diptyque avec le témoignage de la rescapée. Là où elle témoignait seule, la Cantate donne voix à des dizaines de témoignages. Là où elle énonçait son récit entre larmes, pudeur, fierté, d'une parole fragile sur une si vaste scène, la Cantate fait entendre un ensemble musicalement élaboré, à la fois simple et somptueux. Là où la rescapée survit à force de ténacité, de courage, et grâce à l'aide d'une voisine hutu, la Cantate déploie la résistance héroïque d'une collectivité de dizaine de milliers de combattants[10]. La Cantate donne au témoignage inaugural l'écho de tout un peuple et dans une forme musicale qui puisse se faire entendre bien au-delà du Rwanda et, peut-être, bien au-delà du temps présent.
Je tiens à rappeler, c’est essentiel, que ces transgressions des limites ordinaires de la représentation, n’étaient nullement désirées, elles se sont imposées de manière imprévue.
Le témoignage de la rescapée devait bien ouvrir la représentation mais, dans notre esprit, joué par une comédienne. Un travail fait sur le premier livre de Yolande Mukagasana[11] avait produit une sorte de grand résumé approuvé par l'auteur. Restait à trouver la comédienne. Toutes celles qui furent pressenties refusèrent, aucune Rwandaise (ni même une comédienne blanche, solution extrême) n'accepta de « jouer » ce récit alors que Yolande était vivante et présente. Yolande Mukagasana nous proposa alors de le faire elle-même. Il fallut s'y résoudre et ce qu'y se gagna allait devenir essentiel, fondateur.
Une fois cette option prise, sa mise en forme scénique devint de plus en plus dépouillée. Au départ, le grand mur rouge du fond de scène devait s'ouvrir pour laisser entrer cette « apparition » avec accompagnement musical... Elle serait vêtue du costume rwandais dit « traditionnel ». L'orchestre devait ponctuer régulièrement son récit, notamment quand elle était trop émue pour continuer, etc. Tout ceci fut essayé et cette théâtralité, quasi d'opéra, fut progressivement rejetée. Au final, la rescapée, en costume de ville ordinaire, se trouve assise sur une simple chaise de fer. Non pas au centre, mais légèrement décalée et la chaise un peu oblique. Pourquoi ? Pour lui permettre aussi bien de faire face au public - presque tout le temps - ou de se détourner un peu, par moments, recueillie en elle-même. Et pour le public, le fait qu'elle ne soit ni près, ni centrale, ni vraiment face à lui, permet mieux au spectateur de traverser cette heure souvent, déjà, très éprouvante pour lui. De même, il est fixé qu'au premier moment où Yolande Mukagasana pleure (et cela se produit inévitablement), elle prend un mouchoir, s'essuie puis dit : « Excusez-moi ». Elle n'a évidemment à s'excuser de rien, mais elle indique par-là clairement au spectateur que s'il lui est impossible d'éviter l'émotion, le témoignage n'a pas pour but de la provoquer ou de s'y complaire, mais d’offrir un document historique. Avec Yolande nous transgressons une limite du théâtre : elle n’est pas comédienne, elle raconte sa vraie histoire, elle pleure vraiment ; et nous produisons dans le même temps de la limite : elle représente au plus haut degré par la conscience qu’elle manifeste de parler pour un million de morts, par ailleurs, elle respecte toutes les obligations de base d’une comédienne : elle se tient strictement aux 55 minutes imparties, sans refouler ses émotions elle les domine, quand elle pleure, elle attend que son micro soit coupé pour pouvoir se moucher puis laisse passer trois secondes pour qu’on puisse le rouvrir, etc.
De même, la décision d'oser une conférence magistrale et didactique en plein milieu du spectacle, ne faisait absolument pas partie des options initiales. L'idée de départ consistait à livrer toutes les informations fondamentales au spectateur à travers un grand débat télévisuel. Fiction, suite. Deux des auteurs du collectif d'écriture s'essayèrent longuement à écrire cette scène. Des dizaines de pages qui finirent toutes à la poubelle... En effet, nous ne pûmes jamais résoudre la contradiction entre l'objectif de communiquer des informations complexes et l'évocation réaliste, crédible, d'une émission de télévision... Ou bien, cela y ressemblait, avec interruptions sauvages et prises de bec, temps chronométré par l'animateur, etc. Et rien, mais véritablement rien, de substantiel n'était offert au spectateur. Ou bien, des explications approfondies étaient données et le « débat » ne ressemblait plus du tout à de la télévision... Aussi, finalement, le collectif se résolut à demander à Jacques Delcuvellerie d'assumer franchement le rôle d'un conférencier, dans une sorte de suspens du spectacle, lumière rallumée dans la salle.
Ainsi, il y a bien, oui, nous ne pouvions l'éviter, certaines transgressions d'une limite ; mais également, par divers moyens, production de limite. Ce mouvement habite toute la production. Le crime de génocide est si abominable et la confrontation de la représentation vivante à sa réalité si impossible, que si l'on ne transgresse pas, on rend l'événement presque ordinaire (presque acceptable), mais si l'on ne produit pas, de mille façons « de la limite », on se prive moralement et artistiquement de toute possibilité fructueuse de réparation symbolique.
C’est toujours sur ce thème que je vous relate, pour conclure, deux exemples concrets particulièrement frappants puisqu’ils se sont produits avec le public rwandais. En 2004, dans le cadre de la 10ème commémoration du génocide, le Groupov a joué pour la 1ère fois Rwanda 94 devant des salles composées presqu’exclusivement de Rwandais : depuis des membres du Gouvernement jusqu’à de simples paysans des collines, tous nécessairement protagonistes des événements mis en scène, combattants, survivants, enfants de victimes, etc. En ces mois d’avril à juin, tout le pays est plongé dans une atmosphère très lourde, très particulière. Dans ces conditions, le public rwandais s’est révélé – à notre étonnement – très proche des publics occidentaux. Il suivait exactement le même chemin, avec les mêmes réactions, à cette différence notable près : tout s’y manifestait avec une intensité décuplée par rapport aux représentations que nous avions vécues jusque-là.
Par conséquent, dans le moment le plus bouleversant, celui du témoignage de la rescapée, si la plus grande partie de la salle pleurait silencieusement – respectant comme elle pouvait les prescriptions de la culture rwandaise qui rejette les manifestations excessives d’émotion – de nombreux spectateurs ne pouvaient retenir des gémissements, des cris, et parfois entraient dans des états incontrôlés. Yolande suspendait alors son récit. Des assistants intervenaient et, éventuellement, évacuaient ces personnes. Yolande attendait puis reprenait la parole, toujours calmement. À l’extérieur, les gens en crise étaient médicalement pris en charge. Le fait remarquable, c’est que presque tous revenaient ensuite dans la salle et suivaient le spectacle jusqu’au bout. Un même individu évacué pouvait, deux heures plus tard, pendant la conférence, rire et applaudir, ou échanger des commentaires avec son voisin. Et aussi : ces manifestations à caractère cathartique n’empêchaient nullement les autres spectateurs de rester concentrés et réceptifs. Comme Yolande, ils attendaient un peu, et le spectacle se poursuivait. Nous restions collectivement dans l’ordre de la représentation.
Transgresser une limite / produire de la limite, se retrouve aussi dans le 2ème exemple, cette fois le principe est mis en œuvre par le public lui-même. À un moment, une actrice se trouve longuement au premier plan, assise face aux spectateurs, et derrière elle, le « Chœur des Morts » (acteurs rwandais) interprète la « Litanie des questions ». Ce déluge verbal, avec orchestre et chant, soulève toute une série de problèmes et pointe des responsabilités historiques. Il est d’un effet assez puissant à la fois sur la sensibilité et l’intellect. Au Rwanda, placée entre ce chœur dans son dos, et le public juste en face d’elle, l’actrice était parfois en larmes (mais absolument pas « en crise »). Lors d’une représentation à Butare, une femme se leva dans la salle, vint vers la scène et, tendant un mouchoir à la comédienne, elle le lui laissa, retournant ensuite à sa place.
Dans ce cas, la spectatrice transgresse et sans y avoir été invitée, la convention du « 4ème mur » séparant scène et salle. En même temps, ce geste d’empathie très émouvant s’impose des limites : discrétion, presque furtivité. Elle n’est pas montée prendre l’actrice dans ses bras, elle n’a pas pris la parole, elle n’a en rien empêché le spectacle de se dérouler. Elle l’a cependant enrichi d’un signe manifestant que le public comprenait intuitivement et partageait avec nous la convention d’une représentation « à la limite » d’elle-même, c’est-à-dire où celle-ci reste perceptible dans sa transgression même.
Si le théâtre ne peut exister pleinement comme art documentaire qu’à déplacer ses restrictions et ses exclusions et, jusqu’à un certain point, celles du genre documentaire lui-même, cela ne peut s’entreprendre qu’aux conditions que ceux qui s’y emploient acceptent d’abord, en tant qu’individus, de se laisser dé-ranger en profondeur et durablement par la réalité qu’ils désirent affronter. Au fond : accepter d’en être blessés. Ce qui relève du domaine des indispensables conditions préalables. N’en disons rien. C’est là, en effet, une limite dont je ne m’imposerai pas la transgression, fut-elle pondérée.
[1] La pièce écrite relève de la littérature, non du théâtre comme art.
[2] In Sur la limite, vers la fin Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l’aventure du Groupov (roman), p. 357, Ed. Alternatives Théâtrales.
[3] Evidemment, cette puissance constitutive de l’image ne garantit nullement son authenticité, ou la justesse de son emploi.
[4] M-F. Collard, Les collines du silence, in Alternatives théâtrales, n°67-68, pp. 25-26, avril 2001.
[5] On peut trouver un développement à ce sujet dans, par exemple, Rwanda 94, une tentative, in Revue Europe n° 926-927, juin-juillet 2006 : Ecrire l’extrême.
[6] Rien que ces deux conditions feraient fuir aujourd’hui la plupart des coproducteurs, y compris ceux qui nous ont soutenus en ce temps-là. Que nous soyons, nous et beaucoup d’autres, dans l’incapacité totale de réunir aujourd’hui de semblables moyens soulève une question de fond, à examiner bien sûr dans un autre cadre.
[7] Je n’argumenterai pas ici en quoi, pour nous, si elle dérange manifestement une limite, cette réalité scénique relève pourtant bien de la « représentation ». Cela a été longuement fait par ailleurs, cf. par exemple Sur la limite, vers la fin Repères sur le théâtre dans la société du spectacle à travers l’aventure du Groupov (roman), pp. 261-319.
[8] Brecht proposait ironiquement d’appeler ainsi son travail, à ceux qui l’accusaient de ne pas vraiment faire du « théâtre ».
[9] Cette transgression pondérée du simulacre est plus policée que celle du témoignage. Par son contenu, bien sûr, mais aussi du fait que le théâtre a déjà utilisé la situation de la conférence dans l’ordre de la fiction.
[10] Dont il ne reste qu’une poignée de survivants qui, de n’être pas morts au combat, meurent à présent de tristesse, seuls. La Cantate ne se termine pas sur une note héroïque, mais sur le constat d’un deuil inextinguible dans l’état actuel du monde.
[11] Mukagasana, Yolande (1997). La mort ne veut pas de moi. Paris : Éditions Fixot.
